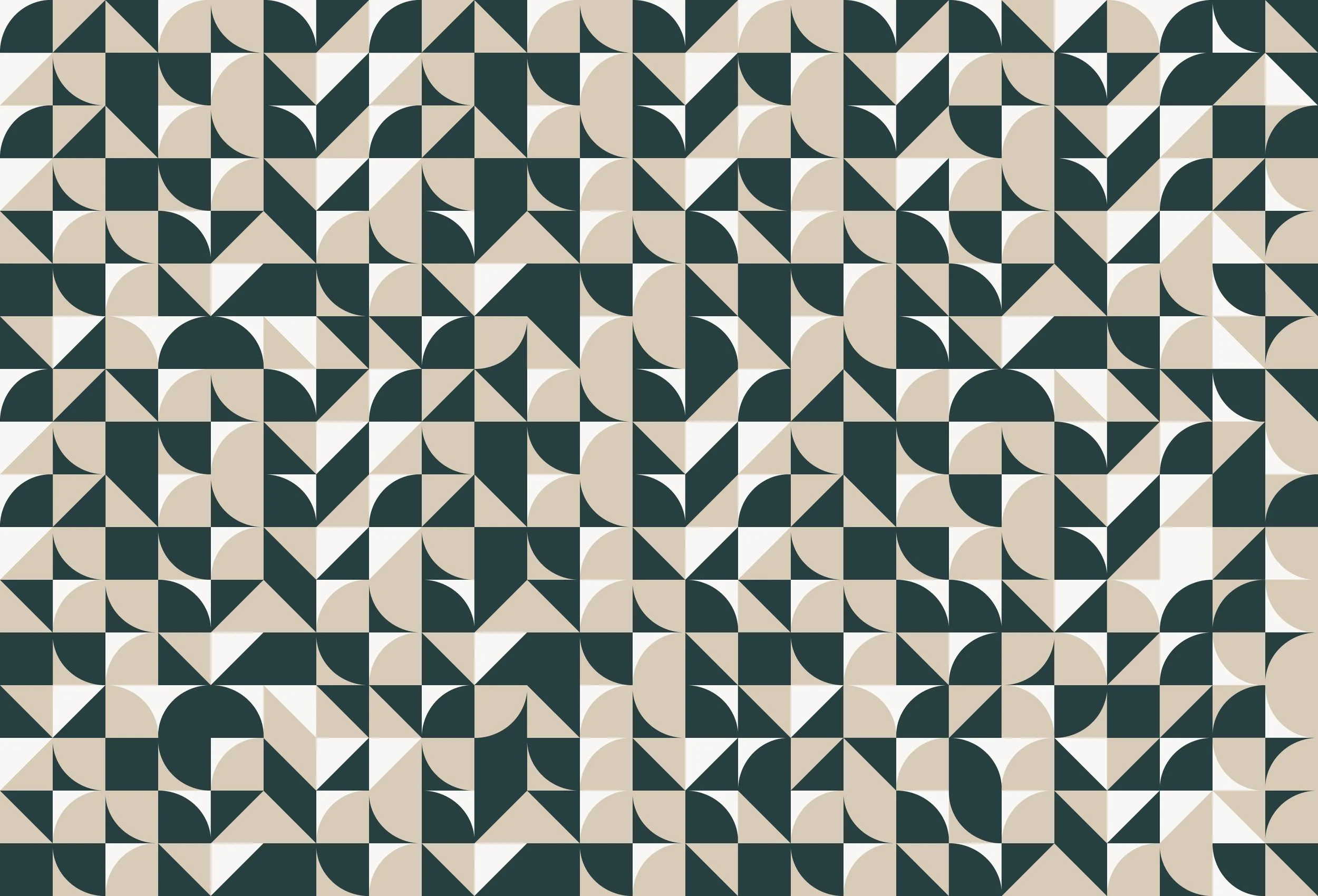Etat, entreprises et transformations de la société
Les enjeux contemporains du droit public économique
Lecture : 15 min | Dernière mise à jour : septembre 2025
Pourquoi ce contenu ?
Le droit public économique s’intéresse au cadre dans lequel l’Etat et les pouvoirs publics interviennent dans l’économie.
Discret mais structurant, il façonne en profondeur la vie des affaires. Face aux grands bouleversements contemporains - transition écologique, nouvelles technologies -, il devient silencieusement un facteur clé pour un nombre croissant d’entreprises.
Leurs activités doivent s’adapter mais peuvent aussi en tirer parti.
Même sans direction juridique interne pleinement structurée, comprendre sa logique permet d’anticiper le moment où un accompagnement est utile ou nécessaire pour saisir des opportunités, prévenir des risques ou réagir face à des difficultés.
C’est l’ambition de ce contenu.
L’analyse qu’il propose s’appuie sur une expérience de cinq années de contentieux économiques devant les juridictions suprêmes françaises, en dialogue constant avec les cours européennes. Il se nourrit aussi des enseignements tirés d’un début de carrière au ministère de l’économie et des finances, au plus près des mécanismes d’organisation de la vie économique par l’État.
Sommaire
1- Evolution de la société, évolution des interventions publiques dans l’économie
Quel sens donner aux interventions publiques dans l’économie ?
2- Les leviers juridiques de l’intervention économique
Quelles formes prennent les interventions publiques dans l’économie et quels enjeux concrets du point de vue des entreprises ?
3 - Transition écologique : intégrer les limites planétaires dans les modèles économiques
Quels enjeux en matière de transition écologique et quelles implications concrètes du point de vue des entreprises ?
4 - Nouvelles technologie et numérique : protéger les droits et assurer un espace de sécurité
Quels enjeux en lien avec les nouvelles technologies et le numérique et quelles implications concrètes du point de vue des entreprises ?
5 - Régulation et répression : une montée en puissance des autorités de régulation
Quelles expressions de la montée en puissance des autorités de régulation et quels enjeux concrets du point de vue des entreprises ?
Conclusion : les enjeux contemporains du droit public économique
Ou quelle(s) logique(s) trouver aux rapports entre l’Etat et les entreprises dans un monde en mutation ?
Evolution de la société, évolution des interventions publiques dans l’économie
Quel sens donner aux interventions publiques dans l’économie ?
Sous l’effet de la mondialisation et des crises successives, la manière dont l’Etat et les pouvoirs publics façonnent l’économie a profondément évolué.
Aux formes classiques d’intervention dans l’économie – par exemple à travers l’encadrement des monopoles, la coopération dans le cadre de contrats publics, ou le recouvrement des impôts et charges sociales – s’ajoutent désormais des modes d’action plus diffus.
Ils sont le résultat de l’intervention de l’Etat lui-même et de ses administrations ou collectivités, mais aussi d’autorités de régulation indépendantes dont le pouvoir est monté en puissance au cours des dernières décennies.
Marché unique oblige, ces modes d’action s’articulent toujours étroitement avec l’Union européenne, voire sont le résultat des politiques publiques et législations qui sont adoptées à cette échelle par l’ensemble des Etats membres.
Aujourd’hui, quelle que soit l’autorité publique qui en est l’instigatrice, les interventions publiques dans l’économie semblent afficher des finalités partagées : garantir l’intérêt général et la stabilité sociale face à des mutations rapides du monde - en lien par exemple avec la transition écologique, la révolution numérique ou le retour des enjeux de souveraineté.
Dans cette nouvelle configuration où l’Etat se présente volontiers comme “stratège”, les entreprises sont transformées en acteurs - volontaires ou contraints - du sens que les pouvoirs publics entendent donner à ces transformations.
Les leviers juridiques de l’intervention économique
Quelles formes prennent les interventions publiques dans l’économie et quels enjeux concrets du point de vue des entreprises ?
Pour concrétiser leurs ambitions, les autorités publiques utilisent le droit. La multitude de règles et outils juridiques mobilisés peuvent schématiquement être regroupés autour de trois “leviers”.
La réglementation
Les autorités publiques fixent des prescriptions et interdictions spécifiques exprimées dans des textes (lois, décrets, règlements etc.)
La régulation
Les autorités publiques orientent et structurent l’activité des entreprises au moyen d’outils plus souples (recommandations, lignes directrices, etc.).
La régulation s’incarne prioritairement dans les missions des autorités de régulation qui sont techniquement spécialisées et statutairement indépendantes des appareils politiques.
La répression
Elle se traduit par des procédures coercitives et d’éventuelles sanctions de la part de ces autorités publiques - administrations, autorités de régulation - et non de la part d’un juge (amendes, name and shame, etc.)
Du point de vue des entreprises
Les pouvoirs publics ne se limitent pas à rédiger des lois mais orientent et structurent le marché dans le but d’atteindre un équilibre entre des intérêts parfois contradictoires.
Pour les entreprises en croissance, comprendre ces dynamiques permet :
d’anticiper les contraintes réglementaires,
de saisir les opportunités liées aux aides, incitations ou nouveaux marchés,
d’éviter ou d’appréhender au mieux des procédures ou sanctions parfois lourdes.
Transition écologique
Intégrer les limites planétaires dans les modèles économiques
Quels enjeux en matière de transition écologique et quelles implications concrètes du point de vue des entreprises ?
Les pouvoirs publics placent progressivement la transition écologique au cœur de leurs stratégies économiques.
Les instances européennes sont sans doute celles qui expriment le plus clairement ce qui est en train de se jouer.
Elles affichent l’ambition collective des Etats membres de “transformer” l’économie et la société pour les placer sur une trajectoire plus durable.
Cette transition vers une économie dite “soutenable” repose sur un triptyque de finalités :
la réduction effective des émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs chiffrés renforcés par le “Green Deal” européen (- 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990 ; “neutralité climatique” d’ici 2050) ;
la préservation de la biodiversité aujourd’hui menacée d’effondrement ;
une gestion raisonnée des ressources naturelles universellement reconnues comme limitées.
Du point de vue des entreprises
Les implications concrètes sont multiples :
de nouvelles obligations sont imposées. Par exemple, dans le cadre de la mise en oeuvre d’une économie circulaire, de nouvelles exigences sont fixées en matière d’éco-conception ou de gestion des déchets, ou encore de responsabilité élargie du producteur.
le recours aux instruments économiques a pour logique d’internaliser le coût environnemental. Par exemple, de plus en plus de secteurs sont couverts par le système d’échanges de quotas d’émission (SEQE) qui entraîne un effet direct sur le prix du carbone.
les nouvelles réglementations incitent à une pression accrue des investisseurs et clients en matière de durabilité. L’adoption d’une taxonomie européenne a ainsi établi les critères pour déterminer si une activité économique - et l’investissement dont elle peut faire l’objet - sont considérés comme “durables”. Autre exemple, les entreprises de toutes tailles font - ou pourraient faire - l’objet d’obligations croissantes en matière de reporting et de “vigilance” sur leur chaine d’approvisionnement.
les opportunités de financement se redessinent. Les incitations positives sont ainsi renforcées tandis que les subventions préjudiciables à l’environnement sont progressivement supprimées.
Nouvelles technologies et numérique
Protéger les droits et assurer un espace de sécurité
Quels enjeux en lien avec les nouvelles technologies et le numérique, et quelles implications concrètes du point de vue des entreprises ?
C’est un lieu commun : les technologies ont transformé les économies comme les sociétés.
Elles soulèvent - entre autres défis - des enjeux de souveraineté et de démocratie.
L’action publique se donne pour objectifs :
de préserver la concurrence en assurant notamment aux petites et moyennes entreprises un accès équitable aux services dominés par les géants du numérique ;
de protéger les droits fondamentaux, au premier rang desquels la vie privée et la liberté d’expression ;
d’assurer la sécurité des espaces interconnectés.
Du point de vue des entreprises
En pratique, cet encadrement se manifeste principalement par :
des obligations réglementaires renforcées. Par exemple, en matière de protection des données ou, plus récemment, en matière d’intelligence artificielle.
un encadrement attentif du marché numérique. Par exemple, la législation récente et les autorités de concurrence veillent à ce que les géants du numérique (“gatekeepers”) permettent à l’ensemble des plus petites entreprises de proposer leurs services sur les plateformes dont elles contrôlent l’accès.
des risques de sanctions significatifs en cas de non-conformité. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sanctionne par exemple sévèrement le recueil de données sans consentement des utilisateurs.
Régulation et répression
Une montée en puissance des autorités de régulation
Quelles expressions de la montée en puissance des autorités de régulation et quels enjeux concrets du point de vue des entreprises ?
Avec la multiplication des normes et la dimension systémique des enjeux collectifs qu’elles protègent, l’Etat a doté les autorités de régulation de pouvoirs de plus en plus structurants et répressifs.
Techniquement spécialisées, elles sont statutairement indépendantes des pouvoirs politiques.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la législation dont elles assurent le contrôle, elles n’en conduisent pas moins de véritables politiques publiques en déployant d’importants efforts sur certains enjeux particuliers (par exemple actuellement, sur le numérique et les nouvelles technologies ou la mise en oeuvre de la transition écologique).
Les normes qu’elles édictent sont souples en apparence – lignes directrices, recommandations etc – mais leurs effets sont contraignants.
Elles poursuivent également une politique répressive, notamment marquée par des sanctions dissuasives.
Leur arsenal s’est d’ailleurs élargi : certaines autorités utilisent désormais des moyens d’enquêtes lourdes autrefois réservés aux enquêtes pénales, comme les perquisitions ou les interrogatoires.
Alors même que la sévérité de cette répression « administrative » s’est accrue, les garanties procédurales qui les encadrent ne sont encore reconnues qu’au fil des contestations portées devant le juge (par exemple en matière d’impartialité ou de droits de la défense).
Du point de vue des entreprises
La montée en puissance des autorités de régulation emporte plusieurs implications concrètes :
des normes “souples” en apparence constituent de vraies contraintes qui orientent les pratiques de marché. Elles sont souvent établies en dialogue avec les entreprises concernées (par exemple dans le cadre de consultations publiques).
les entreprises et leurs dirigeants peuvent faire l’objet d’enquêtes intrusives (perquisitions, interrogatoires) et non plus de simples contrôles, avec des garanties procédurales encore en construction.
les sanctions peuvent être lourdes et comporter une dimension dissuasive qui s’inscrit dans la politique répressive de ces autorités (enjeux financiers et réputationnels).
Les enjeux contemporains du droit public économique
Ou quelle(s) logique(s) trouver aux rapports entre l’Etat et les entreprises dans un monde en mutation ?
A l’image de la société à laquelle elle tente de s’adapter, l’action publique se déploie désormais dans un environnement marqué par la complexité et l’incertitude.
Mais cette complexité n’est pas dépourvue de cohérence. Elle traduit les efforts des autorités publiques - Etat et ses administrations, autorités de régulation, Union européenne - pour orienter la société et le marché vers des équilibres délicats face aux bouleversements contemporains.
Les manifestations du droit - réglementation, régulation, répression - relèvent ainsi de paramètres stratégiques, que les entreprises en croissance ont tout intérêt à intégrer à leurs choix et à leur gouvernance.
C’est sans doute là que se dessinent des enjeux clés du droit public économique.